Le grand Livre
240 pages • Dernière publication le 27/03/2024
Dans le cadre de son Action culturelle,
la SACD soutient la création de cet ouvrage

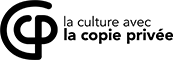
« Un théâtre sans divertissement ? », par Armand Eloi
Si je ne devais m'en tenir qu'à la douloureuse expérience de « L'histoire des larmes »* vécue cet été en Avignon, je me contenterais du commentaire de ce petit garçon des « Habits neufs de l'empereur » d'Andersen, « Mais l'empereur n'a pas d'habit du tout ! » Il aura fallu bien de l'imagination et du snobisme aux commentateurs de France Culture entendus quelques heures plus tôt pour justifier ce fatras de propos creux et imbéciles, cette boursouflure narcissique. Il ne s'agit pourtant là que l'un des ultimes avatars de ce « post-modernisme » qui gangrène notre métier depuis quelques années, un courant qui « ne prétend plus rendre compte d'un état du monde ou des hommes mais seulement des chaos qui sont liés aux fonctionnements de plus en plus mal maîtrisés des sociétés... qui met au premier plan une réalité discontinue, fragmentée, ...archipélique » (Pierre Hivernat).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet état de choses, qu'il faudra étudier dans ces colonnes : une politique culturelle installant systématiquement à la tête des institutions des metteurs en scène « scénographes » plus que des directeurs d'acteurs, la paupérisation de ces acteurs et leur précarisation à travers une discontinuité excessive de l'emploi, une crise de l'expertise culturelle, une régionalisation mal maîtrisée qui donne un pouvoir excessif à des « officines culturelles », une crise de la formation artistique qui dévalorise systématiquement le savoir faire au profit de l'expression personnelle, « l'événementialisation » et la « festivalisation » de l'offre culturelle, privilégiant le coup médiatique à l'action dans la durée...
Je voudrais réfléchir ici sur la diabolisation au sein des élites culturelles de la notion de « divertissement » et sur ses conséquences.
L'existence en France d'un puissant secteur public de la culture a progressivement creusé le fossé avec le secteur privé, auquel sont accolés des termes tels que « théâtre commercial », « boulevard », « théâtre de divertissement ». Là où la différence pourrait n'exister qu'au niveau des moyens de production et de la démocratisation de l'accès, la divergence la plus criante est apparue dans les contenus : d'un côté, l'absence de contraintes de fréquentation et de recettes favorisent la recherche formelle et la « prise de risques », que l'on peut percevoir tantôt comme de « l'excellence artistique » et de la « modernité », tantôt comme des dérives branchées, de l'autre la nécessaire rentabilité financière conduit les producteurs à la recherche de succès assurés - si tant est que cela existe – basés sur la reprise ou la création d'œuvres souvent légères et parfois sans profondeur, et sur une « starisation » coûteuse et suicidaire.
Jusqu'à ces dernières années, il subsistait quelque chose de commun à toutes les productions, une notion partagée de ce que l'on peut appeler le genre « théâtre ». Comment le définir ? Je dirais qu'il s'agit de raconter une histoire exprimée sous forme de dialogues (ou de monologues) au moyen de personnages interprétés par des acteurs devant un public. Ce théâtre est en quelque sorte un miroir de la vie. De Sophocle à Beckett en passant par Molière, Hugo, Voltaire ou Feydeau, à travers des styles variés, il a permis au spectateur de s'identifier aux personnages, de reconnaître les situations vécues par eux, d'y trouver un plaisir libérateur, cette « catharsis » qu'Aristote définit come une « purge de l'âme ». C'est ce théâtre, je crois, qui a donné à beaucoup d'entre nous l'envie de devenir acteurs ou metteurs en scène. Ce théâtre est aussi, d'une manière ou d'une autre, divertissant, non pas qu'il soit forcément comique ou conventionnel, mais parce qu' il nous propose de nous abandonner pour quelques minutes ou quelques heures à la magie d'une fiction, de renoncer momentanément à notre « moi » critique et distant pour nous laisser délicieusement confondre par les artifices de la narration et par la magie évocatrice du verbe. J'ai bien du mal, je l'avoue, à renoncer à cette empathie que je ressens – trop rarement – avec les acteurs et spectateurs d'un spectacle réussi. Mea culpa ! J'aime ressentir ces émotions !
Or voici que depuis quelques années, le théâtre public ou subventionné me paraît traversé par une idéologie de rupture : on y rejette à la fois psychologie, personnages, identification, narration, dialogues. Le texte se fait mur de mots, les acteurs « dansent » ou éructent, paraissent « agis » plus qu'ils n'agissent, le chaos envahit la scène, il n'y a plus pièce mais « performance », voire « installation ». Le spectateur est lui invité à apprécier l'audace de la démarche, la fulgurance du concept. Souvent – c'est le cas chez un Rodrigo Garcia – cela prend l'allure d'une vigoureuse critique de notre société bourgeoise et marchande, alors que c'est tout le contraire : catalogue de poncifs bien pensants, fausse provocation et vraie consensualité ( quel audace il y a-t-il, par exemple, à être anti-américain devant un public acquis ?) En fait il ne s'agit plus tant de présenter un spectacle que de créer un événement, ce qui est paradoxalement bien dans la ligne de la société de consommation.
Que cet « autre » théâtre existe, il n'y a rien là que de très démocratique et légitime. Il n'y a pas de définition objective du théâtre, et c'est tant mieux. Là où la situation devient plus gênante, c'est quand les tenants de cette prétendue modernité prennent le pouvoir au sein du service public de la culture et tentent de « ringardiser » tous ceux qui ne se plient pas à la nouvelle mode. Même si cette tendance est présente chez certains artistes (je me suis fait traîter de « mercantile » par un camarade à qui je parlais de mon souci du public !), c'est surtout parmi les « décideurs » qu'on la voit pulluler. Tout à leur souci de justifier leur propre position par leur clairvoyance et leur modernité, les petits faiseurs de mode ont tendance à fustiger tout ce qui a un air de « déjà vu ». Montez aujourd'hui une pièce de manière « classique », avec une histoire et des personnages dotés de psychologie, et l'on vous dira aussitôt que « ça fait théâtre privé ». Je n'en peux plus d'entendre dans tous les débats qui ont lieu depuis la crise de 2003 répéter sur tous les tons « recherche ! », « laboratoire ! », « nouvelles formes ! ». A côté des « chercheurs en théâtre », il faut bien d'honnêtes artisans qui prennent par la main des spectateurs souvent curieux et ouverts pour les emmener pas à pas sur les chemins de l'inconnu.
Mais pourquoi ce rejet de la narration, des personnages, de ce qui fait sens dans le théâtre ?
(Texte destiné à être publié en 2007 dans le bulletin numéro 9 des Lettres de l'APMS, qui n'a pu paraître notamment en raison du retrait de Jacques Rosner, qui assurait la direction rédactoriale de ces lettres syndicales créées à l'initiative de Jean-Pierre Miquel.)
* « L’histoire des larmes », spectacle de Jan Fabre, joué au Festival-In d’Avignon en 2005

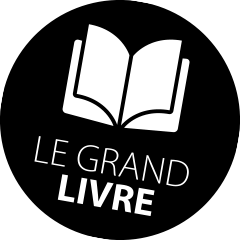
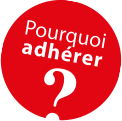




 Inscription à la
Inscription à la